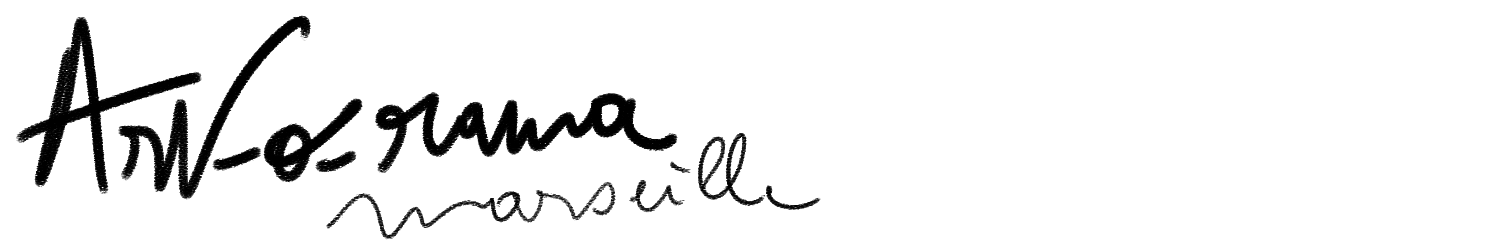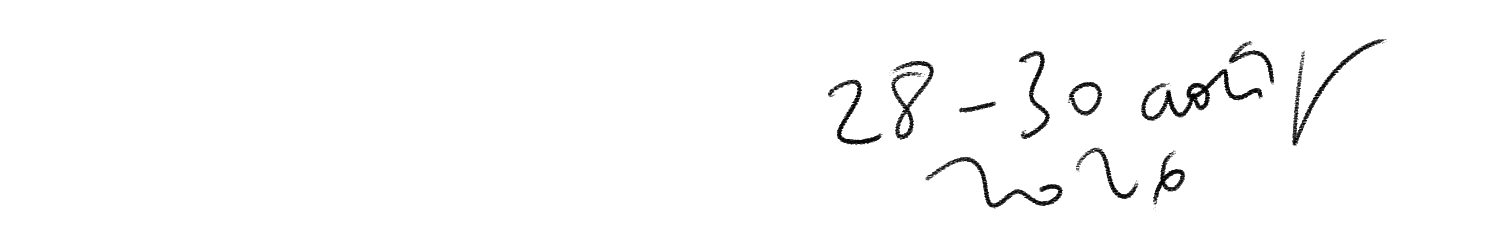Emmanuel Hervé, Paris
Ana Mazzei
Le trabalho d’Ana Mazzei
Wagner Morales
Ana Mazzei est une artiste qui fait son trabalho. Ici, le mot en portugais n’a pas le sens que lui donne sa traduction usuelle. Trabalho signifie travail, boulot. Le travail de Mazzei est d’une autre nature : il est extramondain ; il est matériel parce qu’on le voit matérialisé dans l’espace ; mais il est aussi dans un ordre au-delà de l’espace, au-delà du monde terrestre. Quand on évoque la notion de trabalho, comme ça, en portugais, on pense aux religions afro-brésiliennes telles que le candomblé et l’umbanda. Il s’agit de religions animistes et syncrétiques issues de religions africaines — originaires du Bénin, d’Angola, du Congo et d’autres pays d’Afrique centrale et de l’ouest —, chrétiennes (le spiritisme et le catholicisme) et de rites indigènes (les esprits de la forêt). Au risque d’être simpliste, on peut dire que pour ces pratiques religieuses le terme trabalho a deux connotations : l’une, c’est le travail en tant qu’ensemble d’actions et de gestes qui constituent et donnent forme au culte en coordonnant la cérémonie ; l’autre, c’est le travail en tant qu’acte de magie. C’est l’opération par laquelle on peut accéder au monde spirituel, au monde invisible, par le biais de quelques objets, actions, offres ou invitations ; c’est une voie de communication. On peut regarder l’œuvre d’Ana Mazzei sous cet angle, comme un ensemble d’actions qui nous donnera des coordonnées dans l’espace, et comme une voie d’accès à des récits qui se trouvent ailleurs.
São Paulo est sans doute la ville la plus cosmopolite du monde : un lieu où se mêlent toutes les nationalités de la planète et tous les peuples migrants du Brésil, un lieu où personne ne vous demande d’où vient “ce drôle de petit accent” et où personne ne vous demande votre nom de famille. C’est la ville la plus accueillante du monde et parfois, aussi, la plus violente. À São Paulo, où vit et travaille Ana Mazzei, on mange du sushi avec du churrasco et de la feijoada ; on boit du vin, de la bière et de la cachaça dans la même soirée ; et on commence
à s’amuser après minuit, l’heure des exús (1). À São Paulo, on écoute du rap et on lit de la tragédie grecque : c’est une ville où le rap est la tragédie grecque. Dans cet endroit il n’y a pas de pureté : si tu es pur, t’es mort ; bye bye, baby! La pureté n’intéresse pas Ana Mazzei. L’artiste se mélange avec tout : l’architecture, les gens,
les mœurs, les couches de vies. Tout l’intéresse. Alors Mazzei fait son trabalho comme ça. Elle organise son monde imaginaire comme un diorama, ces tableaux de grandes dimensions, si populaires au XIXe siècle, qui donnaient aux spectateurs l’illusion d’entrer dans un paysage. Mais il n’y a rien de négatif dans le terme illusion ici, car l’illusion dans les œuvres d’Ana Mazzei est celle du théâtre. Or nous ne sommes pas tous disciples de Platon : nous aimons l’illusion. Comme l’artiste l’affirme elle-même :
“Mes constructions s’approprient les procédures employées dans le théâtre, à la fois esthétiquement et conceptuellement. La qualité théâtrale, avec des objets disposés comme des accessoires, suggère une sorte de cérémonie rituelle inconnue qui place le spectateur comme un interprète. Je crée des scénarios et des ensembles d’objets-installations, scènes, acteurs, dramaturges et silences —, tous déplacés de leur fonction la plus évidente.”
Si je mets l’accent dans son travail sur la théâtralité et sur São Paulo, c’est parce que la ville est une grande scène où défilent sans cesse des personnages variés : les craqueiros nóias [les personnes addictes au crack] qui errent dans les rues, couverts d’un manteau de feutre bon marché ; les bâtiments couverts de graffitis et de tags ; des hommes qui tirent leurs chariots remplis d’ordures à recycler ; des containers géants comblés de débris de ces bâtiments encore et toujours en rénovation ; des bruits de voitures et des sons, toujours très forts, qui proviennent des bars et cafés où l’on passe du punk, du rock, du forró ; des passants, des ouvriers, des dames très chiques, des bobos, etc. Il n’est pas anodin que Mazzei utilise du feutre gris, le même que celui du manteau du craqueiro nóia, ou qu’elle construise des maquettes de villes en vue aérienne, des villes qui sont comme les ruines de théâtres grecs, où “tudo parece que era ainda construção e já é ruina” [où “tout a l’air d’être encore en construction et est déjà en ruine”] (2). Il s’agit d’ordon- ner le chaos pour créer une image folle.
Les objets sont là, les images aussi : un manteau bicolore, des anneaux de gymnastique à côté d’un slip noir, des dessins ou fonds accrochés aux murs… Des accessoires pour une performance à venir ou restes d’une scène que les acteurs viennent de quitter ? Des décors ? Ou encore des dispositifs destinés à être manipulés par le public ? Certains d’entre eux fonctionnent aussi comme des outils d’observation de notre envi- ronnement, comme des viseurs qui dessinent des lignes de fuite. C’est comme si “le cran de mire” et “le guidon” d’un pistolet n’attendaient que notre regard pour s’aligner. Mais ici, il n’y a ni cible certaine, ni projectiles. Il n’y a que des corps qui regardent vers leur liberté. Ces objets nous invitent à bouger dans l’espace afin de trouver une bonne place, mais que nous ne pouvons identifier. La vision proposée par Mazzei est généreuse : s’il n’y a pas de bonne place pour le spectateur, c’est parce que sa place est partout. Nous nous sentons ethnographe, acteur, arlequin ou fou, mais jamais intrus. Oserons-nous les toucher, ces objets aux allures de pièces ritualistes ? Oui ! Car ces objets, insérés dans une logique animiste, attendent quelque chose de nous. Ils sollicitent notre volonté silencieuse et expriment le désir sincère de notre présence.
1. L’exú est un orixá, une entité qui symbolise la communication, la patience, l’ordre et la discipline. C’est le gardien des villages, des villes, des maisons, des choses faites par les êtres humains et du comportement des hommes. Le mot èşù, en yoruba, signifie “sphère”, donc l’exú est aussi mouvement. C’est lui qui doit d’abord recevoir les offrandes afin de s’assurer que tout se passe bien et que sa fonction de messager entre les Orun (le monde spirituel) et les Aiye (le monde matériel) soit pleinement réalisée. En Afrique, à l’époque de la colonisation européenne, l’exú était assimilé à tort par les colons européens
à la figure du diable chrétien, à cause de son style irrévérencieux, provocateur, indécent, astucieux, sensuel, ludique et de la façon dont il est représenté dans le culte africain. Selon la construction théologique Yoruba, cette confusion avec la figure de Satan n’a pas de sens, puisque l’exú n’est pas une entité en opposition à Dieu, et ne peut donc pas être considéré comme une personnification du mal.
2. Caetano Veloso, “Fora da Ordem” (chanson), dans Circuladô, 1991.